Planète Mutante : l'Afrique des Grands Lacs |

 À l'échelle géologique les continents se déplacent, et les climats changent. Pour survivre, les animaux sont contraints de s'adapter. L'évolution est un processus qui façonne l'ensemble des êtres vivants. La terre est en perpétuelle mutation.
À l'échelle géologique les continents se déplacent, et les climats changent. Pour survivre, les animaux sont contraints de s'adapter. L'évolution est un processus qui façonne l'ensemble des êtres vivants. La terre est en perpétuelle mutation.
Trois lacs en Afrique, des hordes de petits poissons y mènent une vie mouvementée, marquée par la compétition, la violence, l'agression, la tromperie et la trahison. Ils doivent aussi faire face à de redoutables prédateurs. Ceux qui ont survécu manifestent un instinct parental exceptionnel. Ils ont évolué plus rapidement que tous les autres vertébrés et sont devenus les poissons les plus intelligents du monde.
Dans l'est de l'Afrique, la croûte terrestre porte une cicatrice de plus de 6400 km de long : la vallée du rift (photo 1 à g. rift en rouge). Sur des millions d'années, trois Grands Lacs s'y sont formés : le lac Victoria, le lac Tanganyika et le lac Malawi (photo 2 du Nord au Sud ->). Cette région regroupe beaucoup d'animaux emblématiques de l'Afrique (photo 3). Ici, les prédateurs et leurs proies se livrent un combat acharné. Des chimpanzés vivent le long de ces lacs (photo 4). Leur société complexe repose avant tout sur le statut social et les liens familiaux qui leur permettent de produire et protéger la génération suivante. Mais la vie en communauté n'est pas toujours paisible. Les chimpanzés ont donc trouvé des moyens de résoudre les conflits et d'assurer la cohésion du groupe.

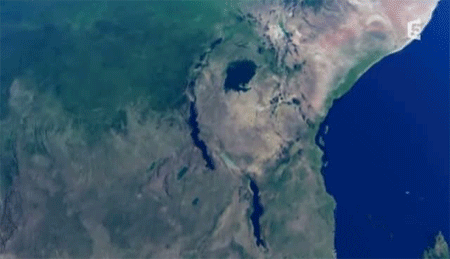



 Au-delà de ces forêts, d'autres animaux des lacs de la vallée du rift mènent une existence qui rappelle celle des grands singes. Ces eaux abritent jusqu'à 1900 espèces de poissons d'eau douce : les cyclidés. Ils sont tous apparentés mais possède une immense diversité de couleurs, de motifs et de formes. Ils vivent en groupe très nombreux mais, deux caractéristiques les distinguent des autres poissons.
Au-delà de ces forêts, d'autres animaux des lacs de la vallée du rift mènent une existence qui rappelle celle des grands singes. Ces eaux abritent jusqu'à 1900 espèces de poissons d'eau douce : les cyclidés. Ils sont tous apparentés mais possède une immense diversité de couleurs, de motifs et de formes. Ils vivent en groupe très nombreux mais, deux caractéristiques les distinguent des autres poissons.
Les cyclidés évoluent plus vite que tous les autres vertébrés et la forte présence des prédateurs a fini par sélectionner des comportements surprenants. Comme celle des chimpanzés, leur vie est pleine de drames, de conflits, de trahisons et de supercheries.

 Beaucoup de cyclidés sont des prédateurs, ils font appel à des techniques de chasse sophistiquées (photo 1 à g.). Celui-ci privilégie l'embuscade, il s'enterre et attend sa proie... Cet autre fait le mort pour attirer les curieux. Même ses ouïes s'arrêtent de bouger. Celui-ci a adopté une troisième tactique : il ressemble à un autre cyclidé inoffensif appelé Pan, il se nourrit de minuscules organismes qui vivent dans le sable. L'imposteur fait mine de manger dans le sable pour s'approcher de ces proies.
Beaucoup de cyclidés sont des prédateurs, ils font appel à des techniques de chasse sophistiquées (photo 1 à g.). Celui-ci privilégie l'embuscade, il s'enterre et attend sa proie... Cet autre fait le mort pour attirer les curieux. Même ses ouïes s'arrêtent de bouger. Celui-ci a adopté une troisième tactique : il ressemble à un autre cyclidé inoffensif appelé Pan, il se nourrit de minuscules organismes qui vivent dans le sable. L'imposteur fait mine de manger dans le sable pour s'approcher de ces proies.
Une autre stratégie est celle du mangeur d'écaille (photo 2 à d.) : il a trouvé une manière de se nourrir sans tuer sa victime. Il commence par repérer sa cible, puis, passe à l'action. Il se jette sur sa proie, saisit les écailles avec ses dents et se contorsionne pour les arracher. Les écailles sont étonnamment riches et très facile à trouver. Toute la journée, les cyclidés s'affrontent...

 Et la nuit, un autre prédateur entre en scène. Les cyclidés n'ont pas de paupières et dorment les yeux ouverts. Une fois assoupie, ils sont sans défense. Ce poisson chat géant est un Kampango (à g.). Ces longues moustaches appelées barbillons sont garnies de papilles qui lui permettent de goûter avant de manger. Les cyclidés endormis n'ont aucune chance de lui échapper...
Et la nuit, un autre prédateur entre en scène. Les cyclidés n'ont pas de paupières et dorment les yeux ouverts. Une fois assoupie, ils sont sans défense. Ce poisson chat géant est un Kampango (à g.). Ces longues moustaches appelées barbillons sont garnies de papilles qui lui permettent de goûter avant de manger. Les cyclidés endormis n'ont aucune chance de lui échapper...
À l'aube, les rôles s'inversent. C'est au tour des prédateurs nocturnes d'être attaqués. Toute la journée, les deux parents Kampangos montent la garde au-dessus de leur nid (à d.). Les cyclidés leur tournent autour et guettent la moindre occasion. Les Kampangos sont des parents attentionnés. Ils défendront leurs petits pendant trois mois jusqu'à ce qu'ils soient capables de se débrouiller seuls. Cyclidés et poissons-chats se livrent à un duel féroce et leurs tactiques sont de plus en plus poussées pour protéger leurs petits et assurer la survie de leur espèce.
 Cette femelle a la bouche pleine d'alevins. C'est une tactique efficace contre des prédateurs en embuscade derrière chaque rocher.
Cette femelle a la bouche pleine d'alevins. C'est une tactique efficace contre des prédateurs en embuscade derrière chaque rocher.
Avec une trentaine d'alevins dans sa bouche, cette femelle reste sans manger pendant plus d'un mois, le temps qu'ils soient assez grand pour s'aventurer dehors.
La mère les fait tourner dans sa bouche pour les oxygéner. Selon les espèces, les femelles cyclidés peuvent élever entre 30 et 100 alevins à la fois. Ces petits poissons ont évolué de façon originale.
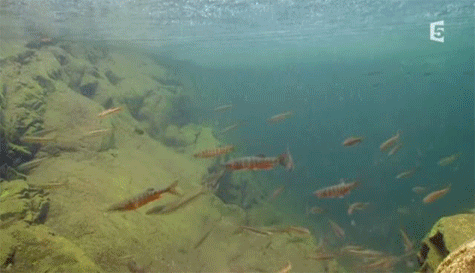
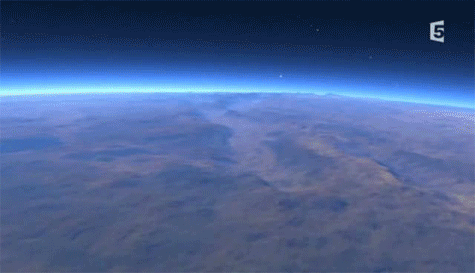 Tout a commencé avec l'apparition des premiers Grands Lacs. Pendant des millions d'années, l'activité volcanique en Afrique de l'Est a étiré et fracturé les plaques tectoniques. Cela a créé une immense faille. Il y a 10 millions d'années, des rivières ont commencé à s'écouler dans cette crevasse et un lac s'est formé : le lac Tanganyika.
Tout a commencé avec l'apparition des premiers Grands Lacs. Pendant des millions d'années, l'activité volcanique en Afrique de l'Est a étiré et fracturé les plaques tectoniques. Cela a créé une immense faille. Il y a 10 millions d'années, des rivières ont commencé à s'écouler dans cette crevasse et un lac s'est formé : le lac Tanganyika.
Les rivières africaines étaient alors peuplées de petits poissons. Certains ont migré dans le lac et ont commencé à s'adapter à ce nouvel environnement. Cela a marqué le début de l'un des épisodes les plus marquants de l'évolution terrestre.
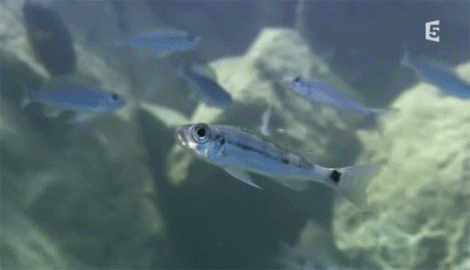
 Les espèces animales évoluées ont en commun la protection de leur progéniture. Une mère chimpanzé élève son petit jusqu'à l'âge de sept ans. Et comme elle se reproduit que tous les cinq ou six ans, chacun est l'objet d'une grande attention. Ce comportement est courant chez les primates et les autres mammifères, pas chez les poissons...
Les espèces animales évoluées ont en commun la protection de leur progéniture. Une mère chimpanzé élève son petit jusqu'à l'âge de sept ans. Et comme elle se reproduit que tous les cinq ou six ans, chacun est l'objet d'une grande attention. Ce comportement est courant chez les primates et les autres mammifères, pas chez les poissons...
Mais les cyclidés ne sont pas des poissons ordinaires. C'est dans le lac Tanganyika qu'ils ont appris leur métier de parents. Les premiers cyclidés avaient un mode de reproduction primitif commun à beaucoup de poissons de mer et des rivières. Ils pondaient leurs oufs sur le fond et les abandonnaient à leur sort. Les prédateurs comme les anguilles ou les autres cyclidés étaient une menace permanente. Les parents se sont donc mis à monter la garde autour de leur progéniture. Mais malgré tous leurs efforts, les pertes étaient nombreuses.
 Le Pr Sato, spécialiste de l'écologie évolutive, étudie les cyclidés Africains depuis 25 ans. Pour lui, c'est la surpopulation qui est à l'origine de cette stratégie défensive. "Les cyclidés dans ces lacs se trouvaient dans un environnement peuplé de nombreuses autres espèces. Je pense que c'est ce qui explique leur évolution rapide". Dans le lac Tanganyika, le Pr Sato étudie des sites où l'on peut observer le stade suivant de cette évolution parentale. Cet amas de coquilles d'escargot d'eau douce est en fait un nid, construit par ce mâle. Le mâle passe des heures à chercher des coquilles dans un rayon de 10 m autour de son nid. Souvent, il se sert chez un voisin, et plus il est costaud, plus il a de chances d'en voler. Chaque coquille sert de maison à une femelle de son harem. Elle y pond ses oufs et élève ses petits en toute sécurité. Mais l'histoire ne s'arrête pas là : le mâle s'empare parfois d'une coquille déjà habitée. Et au lieu de faire bon accueil à l'occupante, il tente de la faire partir. La femelle refuse de bouger, elle protège ses alevins qui se trouvent avec elle à l'intérieur. Mais le mâle ne veut pas des petits d'un autre. Il projette à nouveau du sable pour asphyxier la femelle. Elle finit par abandonner sa coquille. Sous l'oil du mâle, elle cherche désespérément sa progéniture. Mais le mâle revient à la charge. Il la force à partir. Sans protection, les alevins servent de repas à d'autres poissons. Selon le Pr Sato, le mâle a de bonnes raisons de voler des coquilles habitées : "une coquille qui est déjà utilisée par une femelle a de meilleures chances d'être adoptée par une nouvelle femelle dans son nid à lui. Donc c'est un comportement logique". Ce mode de reproduction a entraîné une importante différence de taille entre les mâles et les femelles. Les mâles doivent être grands et forts pour transporter les coquilles jusqu'à leur nid. Les femelles, elles, ont intérêt à être petites pour tenir dedans. L'avantage, c'est que les oufs ont une meilleure chance de survie que s'ils étaient pondus à l'extérieur.
Le Pr Sato, spécialiste de l'écologie évolutive, étudie les cyclidés Africains depuis 25 ans. Pour lui, c'est la surpopulation qui est à l'origine de cette stratégie défensive. "Les cyclidés dans ces lacs se trouvaient dans un environnement peuplé de nombreuses autres espèces. Je pense que c'est ce qui explique leur évolution rapide". Dans le lac Tanganyika, le Pr Sato étudie des sites où l'on peut observer le stade suivant de cette évolution parentale. Cet amas de coquilles d'escargot d'eau douce est en fait un nid, construit par ce mâle. Le mâle passe des heures à chercher des coquilles dans un rayon de 10 m autour de son nid. Souvent, il se sert chez un voisin, et plus il est costaud, plus il a de chances d'en voler. Chaque coquille sert de maison à une femelle de son harem. Elle y pond ses oufs et élève ses petits en toute sécurité. Mais l'histoire ne s'arrête pas là : le mâle s'empare parfois d'une coquille déjà habitée. Et au lieu de faire bon accueil à l'occupante, il tente de la faire partir. La femelle refuse de bouger, elle protège ses alevins qui se trouvent avec elle à l'intérieur. Mais le mâle ne veut pas des petits d'un autre. Il projette à nouveau du sable pour asphyxier la femelle. Elle finit par abandonner sa coquille. Sous l'oil du mâle, elle cherche désespérément sa progéniture. Mais le mâle revient à la charge. Il la force à partir. Sans protection, les alevins servent de repas à d'autres poissons. Selon le Pr Sato, le mâle a de bonnes raisons de voler des coquilles habitées : "une coquille qui est déjà utilisée par une femelle a de meilleures chances d'être adoptée par une nouvelle femelle dans son nid à lui. Donc c'est un comportement logique". Ce mode de reproduction a entraîné une importante différence de taille entre les mâles et les femelles. Les mâles doivent être grands et forts pour transporter les coquilles jusqu'à leur nid. Les femelles, elles, ont intérêt à être petites pour tenir dedans. L'avantage, c'est que les oufs ont une meilleure chance de survie que s'ils étaient pondus à l'extérieur.

 Le stade suivant de l'évolution parentale des cyclidés, s'observe chez le plus gros d'entre eux. Pour pondre, la femelle Kouway qui mesure dans les 50 cm, choisi la méthode traditionnelle. Elle dépose jusqu'à 20.000 oufs sur un rocher. Au bout de quelques jours, les larves sortent. Elles sont toujours attachées à leur sac vitelin qui les nourrira pendant les premières heures. Les petits sont surveillés par leurs deux parents. Mais d'autres cyclidés rodent... Une seconde d'inattention et les prédateurs attaquent. Pour déjouer leur plan, les parents ont adopté une étonnante méthode de défense : ils transportent toute leur progéniture dans leur bouche jusqu'à un endroit plus sûr. Et si cela ne suffit pas, ils recommencent encore et encore... Pour les chercheurs, cette pratique a été l'étape initiale de la stratégie parentale la plus étonnante.
Le stade suivant de l'évolution parentale des cyclidés, s'observe chez le plus gros d'entre eux. Pour pondre, la femelle Kouway qui mesure dans les 50 cm, choisi la méthode traditionnelle. Elle dépose jusqu'à 20.000 oufs sur un rocher. Au bout de quelques jours, les larves sortent. Elles sont toujours attachées à leur sac vitelin qui les nourrira pendant les premières heures. Les petits sont surveillés par leurs deux parents. Mais d'autres cyclidés rodent... Une seconde d'inattention et les prédateurs attaquent. Pour déjouer leur plan, les parents ont adopté une étonnante méthode de défense : ils transportent toute leur progéniture dans leur bouche jusqu'à un endroit plus sûr. Et si cela ne suffit pas, ils recommencent encore et encore... Pour les chercheurs, cette pratique a été l'étape initiale de la stratégie parentale la plus étonnante.
 Une femelle pond des oufs, le mâle les féconde et la femelle les stockent aussitôt dans sa bouche avant que les prédateurs n'aient pu intervenir : c'est ce qu'on appelle l'incubation buccale. Bien en sécurité, les oufs se développent, éclosent et les alevins grandissent. Une semaine plus tard, ils sont prêts à sortir. Mais comme toujours, des hordes affamées les guettent. Le mâle les fait fuir. Les petits retournent vite à l'abri.
Une femelle pond des oufs, le mâle les féconde et la femelle les stockent aussitôt dans sa bouche avant que les prédateurs n'aient pu intervenir : c'est ce qu'on appelle l'incubation buccale. Bien en sécurité, les oufs se développent, éclosent et les alevins grandissent. Une semaine plus tard, ils sont prêts à sortir. Mais comme toujours, des hordes affamées les guettent. Le mâle les fait fuir. Les petits retournent vite à l'abri.
L'incubation buccale est apparue dans le lac Tanganyika il y a plusieurs millions d'années. Elle a ensuite été propagée par une famille de cyclidé très spéciale. Une famille confrontée à un nouvel environnement, a connu une nouvelle évolution accélérée.

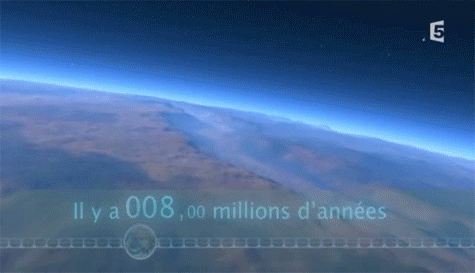 Il y a 8 millions d'années, l'activité tectonique en Afrique de l'Est provoque une autre déchirure dans la croûte terrestre. Le lac Tanganyika déborde, de nouvelles rivières s'écoulent vers le sud et remplissent cette dépression. Au bout de 4 millions d'années, le lac Malawi apparaît. Certains poissons du lac Tanganyika sont emportés vers ce nouveau lac. Mais une seule espèce de cyclidé a survécu à ce voyage de 160 km. Il s'agirait d'une espèce qui pratique l'incubation buccale : celle des aplocrominiens. "Il y a sans doute une seule espèce qui a colonisé le lac. La migration du lac Tanganyika au lac Malawi ne s'est pas faite en un jour. Elle a nécessité un long périple sur des kilomètres de rivières", Pr Tom Kocher, généticien de l'évolution. Les aplocrominiens se seraient reproduits en chemin et l'incubation buccale aurait assuré la survie des petits.
Il y a 8 millions d'années, l'activité tectonique en Afrique de l'Est provoque une autre déchirure dans la croûte terrestre. Le lac Tanganyika déborde, de nouvelles rivières s'écoulent vers le sud et remplissent cette dépression. Au bout de 4 millions d'années, le lac Malawi apparaît. Certains poissons du lac Tanganyika sont emportés vers ce nouveau lac. Mais une seule espèce de cyclidé a survécu à ce voyage de 160 km. Il s'agirait d'une espèce qui pratique l'incubation buccale : celle des aplocrominiens. "Il y a sans doute une seule espèce qui a colonisé le lac. La migration du lac Tanganyika au lac Malawi ne s'est pas faite en un jour. Elle a nécessité un long périple sur des kilomètres de rivières", Pr Tom Kocher, généticien de l'évolution. Les aplocrominiens se seraient reproduits en chemin et l'incubation buccale aurait assuré la survie des petits.
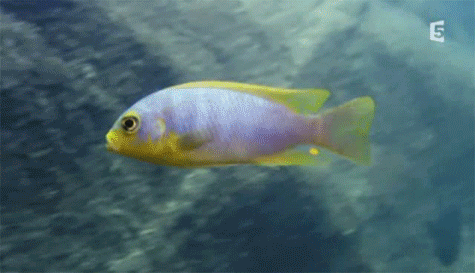
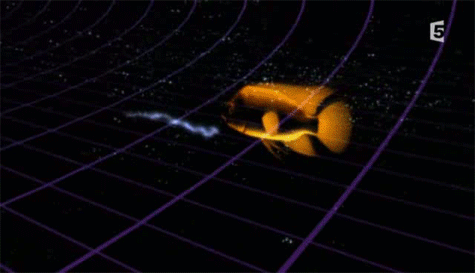 Un événement sans précédent s'est ensuite produit dans le lac Malawi. En seulement un peu plus d'un million d'années, les cyclidés sont passés d'une espèce à plus de 500. Les chimpanzés et les hommes on veut aussi diverger à partir d'un ancêtre commun, mais il a fallu 10 millions d'années pour que cet ancêtre donne naissance aux trois grands singes et à l'homme moderne. L'évolution des cyclidés a été bien plus rapide et plus diversifié. Chez les primates, ce mécanisme s'est accéléré quand les premiers singes ont quitté la forêt pour la savane, se séparant ainsi géographiquement de l'ancêtre commun. Dans le lac Malawi, les cyclidés ne peuvent s'éloigner de leurs voisins. Pourtant, de nouvelles espèces apparaissent en quelques centaines d'années seulement. "C'est la vitesse de spéciation la plus rapide des vertébrés. C'est donc un modèle pour l'étude de l'évolution. L'intérêt c'est que ça se produit aujourd'hui même dans le lac Malawi, ça se fait rapidement et sous nos yeux", Pr Tom Kocher.
Un événement sans précédent s'est ensuite produit dans le lac Malawi. En seulement un peu plus d'un million d'années, les cyclidés sont passés d'une espèce à plus de 500. Les chimpanzés et les hommes on veut aussi diverger à partir d'un ancêtre commun, mais il a fallu 10 millions d'années pour que cet ancêtre donne naissance aux trois grands singes et à l'homme moderne. L'évolution des cyclidés a été bien plus rapide et plus diversifié. Chez les primates, ce mécanisme s'est accéléré quand les premiers singes ont quitté la forêt pour la savane, se séparant ainsi géographiquement de l'ancêtre commun. Dans le lac Malawi, les cyclidés ne peuvent s'éloigner de leurs voisins. Pourtant, de nouvelles espèces apparaissent en quelques centaines d'années seulement. "C'est la vitesse de spéciation la plus rapide des vertébrés. C'est donc un modèle pour l'étude de l'évolution. L'intérêt c'est que ça se produit aujourd'hui même dans le lac Malawi, ça se fait rapidement et sous nos yeux", Pr Tom Kocher.
Pourquoi les cyclidés ont-ils muté et évoluer si rapidement ? La profondeur du lac Malawi varie entre 250 et plus de 700 m. Le vent et les orages font circuler les minéraux du fond vers la surface (à d.). Ces nutriments permettent aux planctons et à d'autres aliments de se multiplier. Une compétition intense s'engage pour la nourriture. Les cyclidés doivent alors se spécialiser ou mourir... Certains s'adaptent pour pouvoir aspirer le sable, filtrer les nutriments microscopiques qu'il contient et rejeter les déchets. D'autres, apprennent à gober du plancton invisible en suspension dans l'eau.


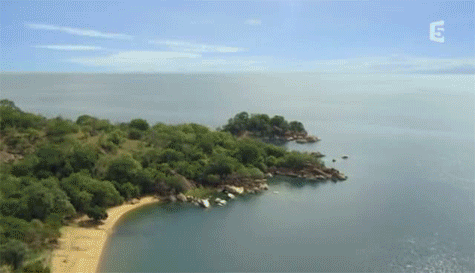 La lumière du soleil qui traverse la surface permet aux algues de pousser sur des rochers jusqu'à 10 m de profondeur. Elles servent de nourriture à un autre groupe de cyclidés : les Mbunas. Ces derniers ont évolué pour se partager les algues. Ce mâle s'est approprié plusieurs rocher. Il autorise les femelle à se nourrir sur son territoire pour pouvoir s'accoupler avec elles. Mais il repousse les autres mâles. à l'exception de quelques-uns... Il ne tolère en fait que ceux qui se nourrissent perpendiculairement au rocher. Celui-ci ouvre ses mâchoires à 180° pour coller au plus près à la paroi. Il utilise ces courtes dents pour ratisser les cellules microscopiques sur les algues. Il ne mange pas les algues elles-mêmes et c'est uniquement pour cette raison qu'il peut participer au festin. Les dents du propriétaire du rocher ressemblent à des minuscule hachoirs. Et lui, se place à un angle de 30° pour brouter les algues. Les Mbunas ont évolué en 400 espèces. Chacune à des dents et un mode d'alimentation spécifique, ils peuvent donc se partager la nourriture. "Cette forte pression sélective sur la forme des mâchoires et des dents peut rapidement conduire à l'apparition de nouvelles espèces", Pr Tom Kocher.
La lumière du soleil qui traverse la surface permet aux algues de pousser sur des rochers jusqu'à 10 m de profondeur. Elles servent de nourriture à un autre groupe de cyclidés : les Mbunas. Ces derniers ont évolué pour se partager les algues. Ce mâle s'est approprié plusieurs rocher. Il autorise les femelle à se nourrir sur son territoire pour pouvoir s'accoupler avec elles. Mais il repousse les autres mâles. à l'exception de quelques-uns... Il ne tolère en fait que ceux qui se nourrissent perpendiculairement au rocher. Celui-ci ouvre ses mâchoires à 180° pour coller au plus près à la paroi. Il utilise ces courtes dents pour ratisser les cellules microscopiques sur les algues. Il ne mange pas les algues elles-mêmes et c'est uniquement pour cette raison qu'il peut participer au festin. Les dents du propriétaire du rocher ressemblent à des minuscule hachoirs. Et lui, se place à un angle de 30° pour brouter les algues. Les Mbunas ont évolué en 400 espèces. Chacune à des dents et un mode d'alimentation spécifique, ils peuvent donc se partager la nourriture. "Cette forte pression sélective sur la forme des mâchoires et des dents peut rapidement conduire à l'apparition de nouvelles espèces", Pr Tom Kocher.
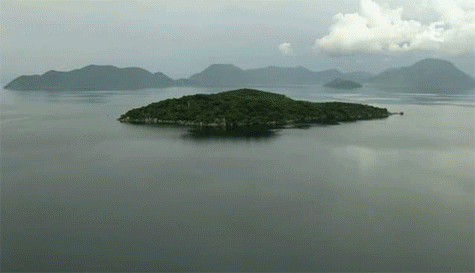 Les cyclidés du lac Malawi sont devenus des ratisseurs, des coupeurs, des racleurs ou des arracheurs. Ils ont formé des espèces différentes qui ne peuvent pas se reproduire entre elles. Mais la concurrence alimentaire ne suffit pas à expliquer une telle diversité. Un autre facteur intervient : l'instinct de reproduction. La plupart des cyclidés du lac Malawi vivent dans une étroite bande le long du rivage, au milieu des rochers ou sur des étendues sablonneuses peu profondes. Dans chacun de ces habitats, le choix des partenaires répond à des critères très exigeant. Les mâles Mbunas arborent des couleurs éclatantes et à la saison des amours, les femelles parcourent les rochers à la recherche du géniteur idéal. Plus leurs couleurs sont vives, plus ils ont de chances d'être de bons reproducteurs.
Les cyclidés du lac Malawi sont devenus des ratisseurs, des coupeurs, des racleurs ou des arracheurs. Ils ont formé des espèces différentes qui ne peuvent pas se reproduire entre elles. Mais la concurrence alimentaire ne suffit pas à expliquer une telle diversité. Un autre facteur intervient : l'instinct de reproduction. La plupart des cyclidés du lac Malawi vivent dans une étroite bande le long du rivage, au milieu des rochers ou sur des étendues sablonneuses peu profondes. Dans chacun de ces habitats, le choix des partenaires répond à des critères très exigeant. Les mâles Mbunas arborent des couleurs éclatantes et à la saison des amours, les femelles parcourent les rochers à la recherche du géniteur idéal. Plus leurs couleurs sont vives, plus ils ont de chances d'être de bons reproducteurs.
 Sur les fonds sableux, les femelles recherchent d'autres qualités. Celle-ci respecte un chantier de construction. Pour impressionner leurs futures campagnes, les mâles font des monticules de sable qui serviront de nuit à leurs oufs. Ces buttes sont construites les unes à côté des autres et les femelles viennent les évaluer. Ce mâle creuse autour d'un petit rocher et entasse le sable pour former une pente. Quand une femelle se montre, il se met à danser pour la séduire. Les femelles passent de nid en nid pour comparer avant de se décider. Celle-ci choisit une butte très pentue, d'autres préfèrent un cône au sommet aplati. C'est le choix opéré par les femelles qui dicte les changements évolutifs. Une nouvelle espèce apparaît quand des femelles sélectionnent uniquement des mâles qui construisent des nids d'une forme particulière, comme celui-ci installé sur un rocher. Certaines femelles privilégient des architectures plus novatrices. Elles ne s'accouplent qu'avec les mâles correspondants, et très vite deux espèces distinctes apparaissent. Cette femelle a choisi de ne s'accoupler qu'avec des mâles qui construisent des nids en pente, sa descendance fera sans doute pareil...
Sur les fonds sableux, les femelles recherchent d'autres qualités. Celle-ci respecte un chantier de construction. Pour impressionner leurs futures campagnes, les mâles font des monticules de sable qui serviront de nuit à leurs oufs. Ces buttes sont construites les unes à côté des autres et les femelles viennent les évaluer. Ce mâle creuse autour d'un petit rocher et entasse le sable pour former une pente. Quand une femelle se montre, il se met à danser pour la séduire. Les femelles passent de nid en nid pour comparer avant de se décider. Celle-ci choisit une butte très pentue, d'autres préfèrent un cône au sommet aplati. C'est le choix opéré par les femelles qui dicte les changements évolutifs. Une nouvelle espèce apparaît quand des femelles sélectionnent uniquement des mâles qui construisent des nids d'une forme particulière, comme celui-ci installé sur un rocher. Certaines femelles privilégient des architectures plus novatrices. Elles ne s'accouplent qu'avec les mâles correspondants, et très vite deux espèces distinctes apparaissent. Cette femelle a choisi de ne s'accoupler qu'avec des mâles qui construisent des nids en pente, sa descendance fera sans doute pareil...
 Fin décembre, c'est le début de la saison des pluies. Les pêcheurs utilisent des lampes pour attirer de petites sardines. Celles-ci sont pourchassées par des poissons-chats qui remontent des profondeurs pour se nourrir. Les parents Kampangos, eux, n'ont pas beaucoup de temps pour chasser. Ils surveillent un nouveau nid plein d'alevins. Les petits font une quinzaine de centimètres de long sans compter leur barbillons. Ils sont impatients d'explorer le lac, mais des cyclidés affamés rodent. Les jeunes doivent pourtant être nourris. Les parents Kampangos ont pourtant trouvé une ruse. Quand la femelle revient de la chasse, ces petits se précipitent vers elle et s'agglutinent sous son ventre. Comme un mammifère qui allaite, elle produit des oufs non fécondés pour les nourrir. Les Kampangos sont les seuls poissons à avoir développé cette capacité.
Fin décembre, c'est le début de la saison des pluies. Les pêcheurs utilisent des lampes pour attirer de petites sardines. Celles-ci sont pourchassées par des poissons-chats qui remontent des profondeurs pour se nourrir. Les parents Kampangos, eux, n'ont pas beaucoup de temps pour chasser. Ils surveillent un nouveau nid plein d'alevins. Les petits font une quinzaine de centimètres de long sans compter leur barbillons. Ils sont impatients d'explorer le lac, mais des cyclidés affamés rodent. Les jeunes doivent pourtant être nourris. Les parents Kampangos ont pourtant trouvé une ruse. Quand la femelle revient de la chasse, ces petits se précipitent vers elle et s'agglutinent sous son ventre. Comme un mammifère qui allaite, elle produit des oufs non fécondés pour les nourrir. Les Kampangos sont les seuls poissons à avoir développé cette capacité.

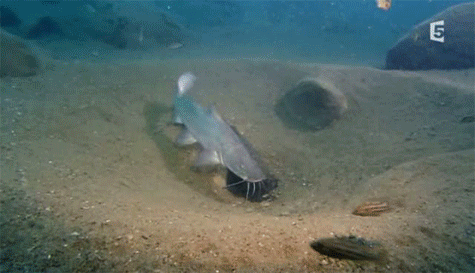 Les Kampangos et les cyclidés coexistent depuis très longtemps. Quand une espèce change, l'autre est obligé de changer aussi sous peine de disparaître. Mais parfois, ils ont recours à des tactiques sournoises et cruelles. Dans les grands lacs africains, l'incubation buccale à obliger les prédateurs à adopter des mesures extrêmes pour percer les défenses ennemies. Car même si ces techniques semblent infaillibles, dans cet environnement peuplé de mutants, rien n'est jamais sûr.
Les Kampangos et les cyclidés coexistent depuis très longtemps. Quand une espèce change, l'autre est obligé de changer aussi sous peine de disparaître. Mais parfois, ils ont recours à des tactiques sournoises et cruelles. Dans les grands lacs africains, l'incubation buccale à obliger les prédateurs à adopter des mesures extrêmes pour percer les défenses ennemies. Car même si ces techniques semblent infaillibles, dans cet environnement peuplé de mutants, rien n'est jamais sûr.
Cette femelle Oreille à la bouche remplie d'oufs, mais certains paraissent étranges. Elles portent les petits oufs jaunes en plus des siens. Ils commencent à éclore et des intrus émergent : des larves de poissons-chats. Après avoir mangé leur sac vitelin, les petits poissons-chats s'attaquent aux oufs des cyclidés. Ce comportement pourrait rappeler celui du coucou, un oiseau qui place son ouf dans le nid d'un autre. Pour la femelle Oreille, l'issue est tragique. Quand la mère recrache ses alevins, il n'y a plus que des poissons-chats. Leur mère a déposé ses oufs justes à côté de ceux de la femelle cyclidée. Et celle-ci sans le savoir, a élevé des parasites qui ont dévoré sa progéniture.
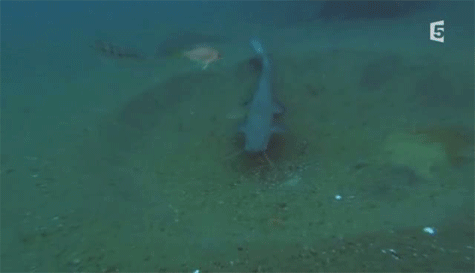
 Le professeur Sato a été le premier à décrire ce comportement chez les poissons. En étudiant les Kampangos, il a découvert que même ses parents parfaits peuvent être vulnérables. Ce nid montre une autre forme de supercherie. Comme d'habitude les parents Kampangos montent la garde. Mais ce ne sont pas leurs petits qu'ils protègent. Ces intrus sont en fait les petits d'une autre espèce de poissons-chats, les Sapuas. Comme les Oreilles, les Kampangos élèvent des usurpateurs qui se sont engraissés en mangeant leurs petits et ils continuent à s'occuper d'eux jusqu'à ce qu'ils quittent le nid. Le professeur Sato s'est longtemps demandé comment les Sapuas réalisaient ce tour de passe-passe. Jusqu'au jour où, en observant de près un nid, il aperçoit de minuscules alevins d'une autre espèce. Ils évitent les barbillons des parents Kampangos et se préparent sans doute à dévorer les oufs non éclos. "J'ai vu un nid de Kampangos avec des oufs et des petites choses noires qui se déplaçaient parmi les oufs. Je crois que ce sont des alevins de Sapuas, je vérifie en regardant les images... C'est bien ça ! Plein de petits alevins de Sapuas qui se déplacent au milieu des oufs de Kampangos. ça faisait plus de 10 ans que je chercher ça !" Le professeur Sato n'a jamais vu des Sapuas construire leur propre nid ou élever leur progéniture. Il est probable qu'ils se contentent d'exploiter l'instinct parental des Kampangos. Ces poissons-chats infiltreraient 15 % des nids de Kampangos.
Le professeur Sato a été le premier à décrire ce comportement chez les poissons. En étudiant les Kampangos, il a découvert que même ses parents parfaits peuvent être vulnérables. Ce nid montre une autre forme de supercherie. Comme d'habitude les parents Kampangos montent la garde. Mais ce ne sont pas leurs petits qu'ils protègent. Ces intrus sont en fait les petits d'une autre espèce de poissons-chats, les Sapuas. Comme les Oreilles, les Kampangos élèvent des usurpateurs qui se sont engraissés en mangeant leurs petits et ils continuent à s'occuper d'eux jusqu'à ce qu'ils quittent le nid. Le professeur Sato s'est longtemps demandé comment les Sapuas réalisaient ce tour de passe-passe. Jusqu'au jour où, en observant de près un nid, il aperçoit de minuscules alevins d'une autre espèce. Ils évitent les barbillons des parents Kampangos et se préparent sans doute à dévorer les oufs non éclos. "J'ai vu un nid de Kampangos avec des oufs et des petites choses noires qui se déplaçaient parmi les oufs. Je crois que ce sont des alevins de Sapuas, je vérifie en regardant les images... C'est bien ça ! Plein de petits alevins de Sapuas qui se déplacent au milieu des oufs de Kampangos. ça faisait plus de 10 ans que je chercher ça !" Le professeur Sato n'a jamais vu des Sapuas construire leur propre nid ou élever leur progéniture. Il est probable qu'ils se contentent d'exploiter l'instinct parental des Kampangos. Ces poissons-chats infiltreraient 15 % des nids de Kampangos.

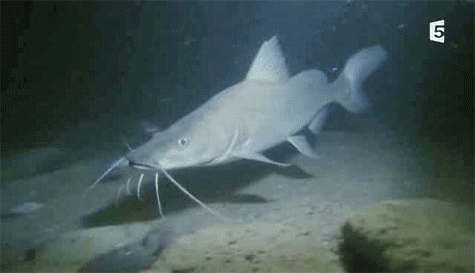 Dans les grands lacs africains la lutte pour la survie ne s'arrête jamais. Mais comme les poissons évoluent tous en parallèle, en général aucun ne prend le dessus. Il arrive cependant que des facteurs externes bouleversent cet équilibre délicat avec des conséquences tragiques. Le lac Victoria est le plus grand lac du continent africain. C'est aussi le plus jeune. Le fond du lac date d'il y a environ un demi-million d'années. Mais l'eau douce qu'il contient actuellement n'a que 12.500 ans. Dans ce court laps de temps, 500 espèces de cyclidés sont apparus. Ce qui a valu au lac Victoria le surnom de rêve de Darwin. Pourtant ces 30 dernières années le rêve a tourné au cauchemar. Des dizaines d'espèces de cyclidés sont en train de disparaître, et beaucoup sont sans doute déjà éteintes. Le suspect numéro un : la Perche du Nil qui peut atteindre 1,80 mètre de long.
Dans les grands lacs africains la lutte pour la survie ne s'arrête jamais. Mais comme les poissons évoluent tous en parallèle, en général aucun ne prend le dessus. Il arrive cependant que des facteurs externes bouleversent cet équilibre délicat avec des conséquences tragiques. Le lac Victoria est le plus grand lac du continent africain. C'est aussi le plus jeune. Le fond du lac date d'il y a environ un demi-million d'années. Mais l'eau douce qu'il contient actuellement n'a que 12.500 ans. Dans ce court laps de temps, 500 espèces de cyclidés sont apparus. Ce qui a valu au lac Victoria le surnom de rêve de Darwin. Pourtant ces 30 dernières années le rêve a tourné au cauchemar. Des dizaines d'espèces de cyclidés sont en train de disparaître, et beaucoup sont sans doute déjà éteintes. Le suspect numéro un : la Perche du Nil qui peut atteindre 1,80 mètre de long.
Cette espèce a été introduite dans le lac dans les années 50. Dès 1990, on en péchait plus de 200 000 t chaque année. Les perches ont dévoré jusqu'à 70 % des cyclidés du lac. Certains cyclidés survivent dans les eaux boueuses peu profondes. Ils se cachent dans les rochers. Ce petit mâle ose sortir de sa cachette pour attirer une campagne. Une femelle pourrait l'apercevoir dans l'obscurité, s'il en reste encore. Avec le temps et les mesures de protection, les cyclidés du lac Victoria seront peut-être sauvées de l'extinction.

 Au-dessus du lac Malawi après deux mois de pluie, un immense nuage de moucherons se forme. Des millions de larves ont grandi dans le lac, à présent, des nuées d'adultes émergent de l'eau pour s'accoupler dans des colonnes de 200 m de haut : un festin pour les oiseaux. Les oufs issus de ces accouplements retombent dans le lac. Les petits Kampangos sortent pour la première fois du nid pour se nourrir des larves des moucherons. Ils les détectent à l'aide de leur barbillons. Les Kampangos font coïncider leur cycle reproducteur avec cet événement saisonnier. Et leurs adversaires, les cyclidés en profitent pour employer une autre ruse.
Au-dessus du lac Malawi après deux mois de pluie, un immense nuage de moucherons se forme. Des millions de larves ont grandi dans le lac, à présent, des nuées d'adultes émergent de l'eau pour s'accoupler dans des colonnes de 200 m de haut : un festin pour les oiseaux. Les oufs issus de ces accouplements retombent dans le lac. Les petits Kampangos sortent pour la première fois du nid pour se nourrir des larves des moucherons. Ils les détectent à l'aide de leur barbillons. Les Kampangos font coïncider leur cycle reproducteur avec cet événement saisonnier. Et leurs adversaires, les cyclidés en profitent pour employer une autre ruse.
Des invités indésirables se sont glissés dans ce nid de Kampangos mais ce ne sont pas les parasites habituels qui mangent les alevins. Ce sont de jeunes cyclidés, ils devraient être en sécurité dans la bouche de leur mère ! Que font-ils là ? Quelques jours plus tôt leur mère a choisi ce nid. Elle y a relâché sa progéniture. Au lieu de retourner vers leur mère, les jeunes cyclidés ont afflué vers le nid de leur ennemi. Bizarrement, les parents Kampangos ne les dévorent pas. Ils sont trop petits pour être mangés. Et cette masse tourbillonnante contribue sans doute à protéger les jeunes Kampangos des prédateurs. Pour la mère cyclidé, placer ses petits dans une famille d'accueil en vaut la peine, même au risque d'en perdre quelques-uns. Ce compromis constitue une trêve dans la lutte entre ses rivaux.
Qui lancera la prochaine attaque ? Sans doute les cyclidés. Leur mode d'alimentation, leur talent de bâtisseurs de nid et leur habileté à tromper l'ennemi sont leurs moyens de survie. Mais en définitive, ce sont leurs étonnantes stratégies parentales qui assurent l'avenir de leur espèce. Dans l'univers tumultueux des grands lacs africains, ces intelligents petits poissons sont les survivants par excellence.
France 5 - Planète Mutante - Natural History New Zealand > 2010 |
|