Planète Mutante : Nouvelle-Zélande |


 À l'échelle géologique les continents se déplacent, et les climats changent. Pour survivre, les animaux sont contraints de s'adapter. L'évolution est un processus qui façonne l'ensemble des êtres vivants. La terre est en perpétuelle mutation.
À l'échelle géologique les continents se déplacent, et les climats changent. Pour survivre, les animaux sont contraints de s'adapter. L'évolution est un processus qui façonne l'ensemble des êtres vivants. La terre est en perpétuelle mutation.
Des îles de glace, dés côtes interminables et des forêts luxuriantes, un pays isolé pendant plus de 80 millions d'années, et des animaux étranges qui ne vivent nulle part ailleurs... Comment sont-ils arrivés sur cet archipel coupé du monde ? Cette énigme s'explique en partie par le comportement et l'évolution génétique de certaines créatures bizarres. Mais la clé du mystère repose aussi au cour de la géologie du royaume des oiseaux.

 La Nouvelle-Zélande est située dans le Pacifique Sud, à 1500 km de l'Australie. C'est la dernière étape avant l'Antarctique. Il est minuit. Un jeune oiseau s'aventure dans le sous-bois. Ce curieux volatile est un Kiwi, et on ne le trouve que dans ce pays. C'est une curiosité de l'évolution. Il a tout d'un mammifère, contrairement aux autres oiseaux, ses narines sont placées au bout de son bec, ce qui lui permet de flairer une proie jusqu'à une quinzaine de centimètres sous terre. Quant à son plumage laineux, il ressemble à celui d'un chien. Le jeune pénètre sur le territoire d'un autre kiwi. Il est vite repéré. Cette poursuite illustre l'une des particularités les plus étonnantes de l'espèce. Les kiwis ne volent pas, ils courent... Leurs ailes minuscules et quasiment invisibles sont les vestiges inutiles d'un passé révolu.
La Nouvelle-Zélande est située dans le Pacifique Sud, à 1500 km de l'Australie. C'est la dernière étape avant l'Antarctique. Il est minuit. Un jeune oiseau s'aventure dans le sous-bois. Ce curieux volatile est un Kiwi, et on ne le trouve que dans ce pays. C'est une curiosité de l'évolution. Il a tout d'un mammifère, contrairement aux autres oiseaux, ses narines sont placées au bout de son bec, ce qui lui permet de flairer une proie jusqu'à une quinzaine de centimètres sous terre. Quant à son plumage laineux, il ressemble à celui d'un chien. Le jeune pénètre sur le territoire d'un autre kiwi. Il est vite repéré. Cette poursuite illustre l'une des particularités les plus étonnantes de l'espèce. Les kiwis ne volent pas, ils courent... Leurs ailes minuscules et quasiment invisibles sont les vestiges inutiles d'un passé révolu.

 Il y a 700 ans environ, à l'époque de la découverte de la Nouvelle-Zélande par les Polynésiens, les mammifères n'existaient pas sur ces terres. Perdues au milieu de l'océan, l'île du Nord et l'île du Sud étaient le domaine des oiseaux.
Il y a 700 ans environ, à l'époque de la découverte de la Nouvelle-Zélande par les Polynésiens, les mammifères n'existaient pas sur ces terres. Perdues au milieu de l'océan, l'île du Nord et l'île du Sud étaient le domaine des oiseaux.
Les Perroquets Alpins règnaient sur les montagnes. De vastes populations d'oiseaux de mer occupaient les côtes. Et les cris des centaines d'autres espèces résonnaient dans les forêts primitives. Au fil des générations, certaines d'entre elles ont perdu la faculté de voler au cours de leur évolution.

 À quoi servent des ailes, quand le sol de la forêt offre un tel festin de petites proies ? En l'absence de mammifères, le Kiwi a adopté un style de vie terrestre similaire à celui du hérisson.
À quoi servent des ailes, quand le sol de la forêt offre un tel festin de petites proies ? En l'absence de mammifères, le Kiwi a adopté un style de vie terrestre similaire à celui du hérisson.
Son bec s'est transformé. Il s'est doté de détecteurs de pression et de vibrations. Il perçoit les plus infimes mouvements sous terre, aucun vers n'est à l'abri. Si ces oiseaux sont incapables de voler, comment ont-ils fait pour rejoindre ce sanctuaire ? La présence de deux autres animaux complique encore cette énigme...

 Le premier est un escargot gros comme le poing. Alors que la plupart de ses congénères se nourrissent de plantes, lui, est carnivore. Lorsqu'il détecte un ver, il l'aspire comme un spaghetti.
Le premier est un escargot gros comme le poing. Alors que la plupart de ses congénères se nourrissent de plantes, lui, est carnivore. Lorsqu'il détecte un ver, il l'aspire comme un spaghetti.
Le second, vient juste de sortir de son ouf : c'est un Sphénodon. Il possède une caractéristique physique qui date d'avant l'ère des dinosaures. Il a un troisième oil sur le dessus de la tête. Cet oil dit pinéale, comprend une cornée, une rétine et un cristallin, et perçoit la lumière. Mais on ignore toujours à quoi il sert... Le petit n'a que quelques heures, son instinct le pousse déjà à quitter le terrier pour trouver refuge dans la forêt. Car un adulte de la même espèce pourrait en faire son repas. Les Sphénodons peuvent atteindre 50 cm de long et vivre plus de 100 ans. Le groupe auquel ils appartiennent est plus vieux que les dinosaures. Aujourd'hui, il n'existe plus qu'en Nouvelle-Zélande.
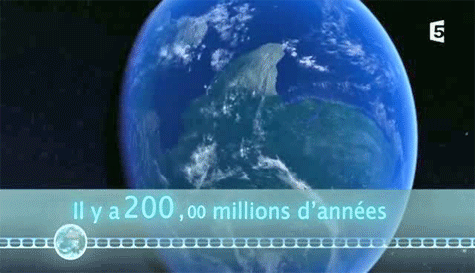 Ces trois groupes, celui du lézard qui remonte à 20 millions d'années, celui de l'escargot qui remonte à 200 millions d'années et celui de l'oiseau coureur qui remonte à 60 millions d'années, partagent donc un archipel de l'océan Pacifique formé il y a 23 millions d'années. Comment sont-ils arrivés là ?
Ces trois groupes, celui du lézard qui remonte à 20 millions d'années, celui de l'escargot qui remonte à 200 millions d'années et celui de l'oiseau coureur qui remonte à 60 millions d'années, partagent donc un archipel de l'océan Pacifique formé il y a 23 millions d'années. Comment sont-ils arrivés là ?
Il y a 200 millions d'années, l'Australie, l'Antarctique et l'Amérique du Sud faisait parti d'un super continent, le Gondwana. Il y a environ 83 millions d'années, une vaste section s'en est détachée et à dériver jusqu'au milieu de l'océan. Ce mini continent a été baptisé la Zelandia. Il abritait les mêmes plantes et les mêmes animaux que le Gondwana. Ainsi, les ancêtres du kiwi, de l'escargot carnivore et du sphénodon se sont retrouvés prisonniers sur cette nouvelle terre.

 Des indices contenus dans ces roches sont à l'origine d'une controverse sur l'histoire de ce mini continent. Dans la forêt de l'île du Sud, le géologue Hamish Campbell a fait des découvertes étonnantes sur le passé géologique du pays. "Voici la preuve que cet endroit était complètement submergé". Des roches indiquent que le ligne de cette rivière était autrefois le fond de la mer. "C'est du calcaire avec beaucoup de fossiles. Le calcaire nous apprend qu'il s'agit d'un sédiment qui s'est accumulé dans la mer. C'est une roche sédimentaire marine, c'est la preuve que ce sédiment s'est formé à une époque où la mer recouvrait ce site, et sur une hauteur deux au moins 80 m".
Des indices contenus dans ces roches sont à l'origine d'une controverse sur l'histoire de ce mini continent. Dans la forêt de l'île du Sud, le géologue Hamish Campbell a fait des découvertes étonnantes sur le passé géologique du pays. "Voici la preuve que cet endroit était complètement submergé". Des roches indiquent que le ligne de cette rivière était autrefois le fond de la mer. "C'est du calcaire avec beaucoup de fossiles. Le calcaire nous apprend qu'il s'agit d'un sédiment qui s'est accumulé dans la mer. C'est une roche sédimentaire marine, c'est la preuve que ce sédiment s'est formé à une époque où la mer recouvrait ce site, et sur une hauteur deux au moins 80 m".
 La géologie de la Nouvelle-Zélande actuelle révèle que la Zelandia reposait sur une croûte très mince et avec une flottabilité très réduite. En 60 millions d'années, l'océan recouvre peu à peu l'ancien continent. Seuls de petits îlots rochers subsistent. La Zelandia reste immergée durant plusieurs millions d'années...
La géologie de la Nouvelle-Zélande actuelle révèle que la Zelandia reposait sur une croûte très mince et avec une flottabilité très réduite. En 60 millions d'années, l'océan recouvre peu à peu l'ancien continent. Seuls de petits îlots rochers subsistent. La Zelandia reste immergée durant plusieurs millions d'années...
Et puis, il y a environ 24 millions d'années, les plaques tectoniques entrent en collision. Elles se plissent avec suffisamment de force pour soulever les bords du continent englouti.
Peu à peu, un fragment de l'ancienne Zelandia refait surface... La Nouvelle-Zélande est née !

 L'ancien continent est parfaitement visible sur cette carte satellite des fonds marins. C'est aujourd'hui un vaste plateau océanique situé parfois à plus de 1500 m de profondeur. La Nouvelle-Zélande actuelle représente moins de 7 % de l'ancien continent. Si les scientifiques s'accordent sur l'émergence de la Nouvelle-Zélande, ils débattent encore pour savoir si toute la Zelandia s'est retrouvée engloutie. Les fossiles marins retrouvés dans les roches calcaires au sommet des montagnes, semblent indiquer que la Zelandia aurait pu être entièrement recouverte par la mer. "On ne peut pas démontrer qu'il y a toujours eu des terres émergées dans cette région, depuis que la Zelandia s'est détachée du Gondwana.
L'ancien continent est parfaitement visible sur cette carte satellite des fonds marins. C'est aujourd'hui un vaste plateau océanique situé parfois à plus de 1500 m de profondeur. La Nouvelle-Zélande actuelle représente moins de 7 % de l'ancien continent. Si les scientifiques s'accordent sur l'émergence de la Nouvelle-Zélande, ils débattent encore pour savoir si toute la Zelandia s'est retrouvée engloutie. Les fossiles marins retrouvés dans les roches calcaires au sommet des montagnes, semblent indiquer que la Zelandia aurait pu être entièrement recouverte par la mer. "On ne peut pas démontrer qu'il y a toujours eu des terres émergées dans cette région, depuis que la Zelandia s'est détachée du Gondwana.
 Et puisqu'on a pas de certitude, une question se pose : est-il possible qu'elle ait été totalement submergée ?" Si c'est le cas, toute la faune qui y vivait, a dû, ou se disperser, ou disparaître. "C'est une idée très contestée. Car si on admet que tout était sous l'eau, il a bien fallu que ces animaux arrivent jusqu'ici. Or, ils n'ont pu le faire que de trois façons : par la mer, portés par le vent ou en volant".
Et puisqu'on a pas de certitude, une question se pose : est-il possible qu'elle ait été totalement submergée ?" Si c'est le cas, toute la faune qui y vivait, a dû, ou se disperser, ou disparaître. "C'est une idée très contestée. Car si on admet que tout était sous l'eau, il a bien fallu que ces animaux arrivent jusqu'ici. Or, ils n'ont pu le faire que de trois façons : par la mer, portés par le vent ou en volant".
Ceci pourrait expliquer l'absence de mammifères. Mais le kiwi a-t-il pu voler jusqu'en Nouvelle-Zélande ? Le sphénodon et l'escargot carnivore ont-ils traversé l'océan sur des branches d'arbres ? Les premiers colonisateurs auraient très bien pu venir par les airs... Le vent peut transporter les graines sur des milliers de kilomètres. Et les oiseaux marins parcourent aussi de grandes distances.

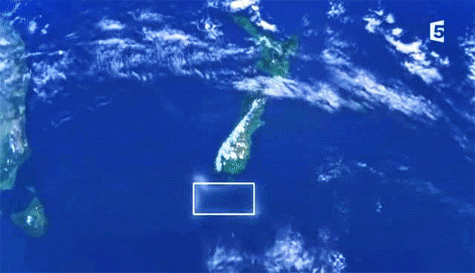 Les îles Snares, au sud de la Nouvelle-Zélande, ressemblent à ce que le pays devait être juste après l'arrivée des oiseaux marins. Un étrange rituel semble indiquer que l'évolution a commencé à dérailler chez les premiers oiseaux. Chaque jour, une heure avant l'aube, un signal invisible pousse de petits oiseaux à sortir de leur terrier. Ce sont des Puffins fuligineux (Puffinus griseus), ils se rassemblent en petits groupes et trottinent le long des sentiers. Leur nombre augmente à chaque carrefour. Ils se dandinent tous dans la même direction, ils sont sûrement incapables de voler pour marcher comme cela depuis près d'une heure. Ils commencent à s'exercer pour la phase suivante... Tous les groupes se rejoignent au bord de la falaise, et juste avant le lever du soleil, les oiseaux prennent leur envol. C'est pour atteindre cette rampe de lancement que tous les matins, ils traversent la forêt. 2 millions de Puffins fuligineux décrivent des cercles avant d'aller pêcher dans l'un des sites les plus riches en poissons de la planète. Les puffins fondent sur leur proies depuis le ciel...
Les îles Snares, au sud de la Nouvelle-Zélande, ressemblent à ce que le pays devait être juste après l'arrivée des oiseaux marins. Un étrange rituel semble indiquer que l'évolution a commencé à dérailler chez les premiers oiseaux. Chaque jour, une heure avant l'aube, un signal invisible pousse de petits oiseaux à sortir de leur terrier. Ce sont des Puffins fuligineux (Puffinus griseus), ils se rassemblent en petits groupes et trottinent le long des sentiers. Leur nombre augmente à chaque carrefour. Ils se dandinent tous dans la même direction, ils sont sûrement incapables de voler pour marcher comme cela depuis près d'une heure. Ils commencent à s'exercer pour la phase suivante... Tous les groupes se rejoignent au bord de la falaise, et juste avant le lever du soleil, les oiseaux prennent leur envol. C'est pour atteindre cette rampe de lancement que tous les matins, ils traversent la forêt. 2 millions de Puffins fuligineux décrivent des cercles avant d'aller pêcher dans l'un des sites les plus riches en poissons de la planète. Les puffins fondent sur leur proies depuis le ciel...

 Mais une autre espèce primitive a évolué d'une façon très différente. Le Gorfou des Snares ne vit que sur cette petite île. Ce manchot est lui aussi un oiseau marin, mais une série de mutations progressives lui a fait perdre sa capacité à voler. Ce poussin, âgé de deux mois, réclame sans cesse à manger. Les parents se relaient, aujourd'hui, c'est au mâle de nourrir son petit. Il rejoint une file d'adultes investis de la même mission qui clopinent à travers la forêt. Ils n'ont pourtant pas un physique de marcheurs. Une falaise escarpée des 90 m les sépare de la nourriture qu'ils viennent chercher pour leur petit. Pourquoi ne peuvent-ils pas voler comme le puffin ? Heureusement, les Gorfous sont tenaces et plein de ressources.
Mais une autre espèce primitive a évolué d'une façon très différente. Le Gorfou des Snares ne vit que sur cette petite île. Ce manchot est lui aussi un oiseau marin, mais une série de mutations progressives lui a fait perdre sa capacité à voler. Ce poussin, âgé de deux mois, réclame sans cesse à manger. Les parents se relaient, aujourd'hui, c'est au mâle de nourrir son petit. Il rejoint une file d'adultes investis de la même mission qui clopinent à travers la forêt. Ils n'ont pourtant pas un physique de marcheurs. Une falaise escarpée des 90 m les sépare de la nourriture qu'ils viennent chercher pour leur petit. Pourquoi ne peuvent-ils pas voler comme le puffin ? Heureusement, les Gorfous sont tenaces et plein de ressources.

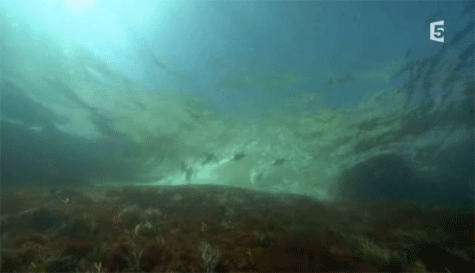 Ils ont raison d'avoir peur de plonger. Des otaries rodent sous le varech... Il faut choisir le bon moment. S'ils hésitent trop longtemps, un volontaire est désigné.
Ils ont raison d'avoir peur de plonger. Des otaries rodent sous le varech... Il faut choisir le bon moment. S'ils hésitent trop longtemps, un volontaire est désigné.
Les Gorfous ont un talent spécial : ils volent sous l'eau. C'est un net avantage sur les autres oiseaux pécheurs.
Mais il leur a fallu du temps pour en arriver là.
Il y a 60 millions d'années, un oiseau géant vivait sur l'ancien continent de Zelandia.

 Le Waimanu est le chaînon manquant entre les oiseaux marins volant et les manchots modernes. Il avait des ailes semblables à celles du puffin fuligineux et une silhouette fuselée qui était déjà l'ébauche de celle des Gorfous. Plutôt que de voler dans les airs, il volait sous l'eau. Mais ses ailes créaient une résistance qui le ralentissait. Il a fini par disparaître... Au fil du temps, les mutations ont transformé ses ailes encombrantes et donner naissance aux manchots modernes. Si son profil est idéal pour la chasse sous-marine, il l'est moins pour la vie sur la terre ferme. Les manchots vont s'épuiser à remonter la pente. Génération après génération, les Gorfous des Snares s'imposent cette épreuve pour nourrir leurs petits.
Le Waimanu est le chaînon manquant entre les oiseaux marins volant et les manchots modernes. Il avait des ailes semblables à celles du puffin fuligineux et une silhouette fuselée qui était déjà l'ébauche de celle des Gorfous. Plutôt que de voler dans les airs, il volait sous l'eau. Mais ses ailes créaient une résistance qui le ralentissait. Il a fini par disparaître... Au fil du temps, les mutations ont transformé ses ailes encombrantes et donner naissance aux manchots modernes. Si son profil est idéal pour la chasse sous-marine, il l'est moins pour la vie sur la terre ferme. Les manchots vont s'épuiser à remonter la pente. Génération après génération, les Gorfous des Snares s'imposent cette épreuve pour nourrir leurs petits.

 Lorsque les manchots et les oiseaux ont colonisé la Nouvelle-Zélande, leurs déjections fertilisaient la terre. Des graines ont germé, puis des forêts sont apparues. D'autres étapes décisives ont façonné ce pays, et de récentes découvertes ont récemment permis de mieux comprendre son histoire.
Lorsque les manchots et les oiseaux ont colonisé la Nouvelle-Zélande, leurs déjections fertilisaient la terre. Des graines ont germé, puis des forêts sont apparues. D'autres étapes décisives ont façonné ce pays, et de récentes découvertes ont récemment permis de mieux comprendre son histoire.
En 2001, au centre de l'île du Sud, des chercheurs de fossiles sont tombés sur une véritable mine d'os et d'arêtes dans les sédiments d'un ancien lac. "On a trouvé des milliers de fossiles identifiables. C'est l'un des sites les plus riches du monde correspondant à cette époque", Alan Tennyson, Paléobiologiste. Ces restes d'oiseaux, de poissons et de reptiles, ont permis d'éclairer une période de flou de l'histoire de la Nouvelle-Zélande : celle qui a suivi son émergence il y a entre 19 et 16 millions d'années.
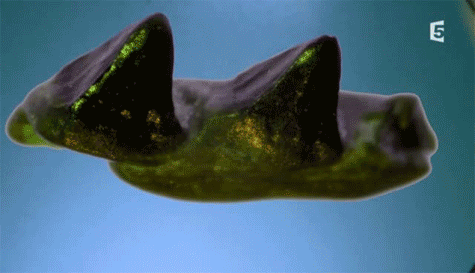
 L'un de ces débris et un fragment de la mâchoire d'un ancêtre du Sphénodon. Le sphénodon est un prédateur patient, il guette dans l'immobilité la plus totale jusqu'au dernier moment. Ses dents sont en fait les bords pointus de ses mâchoires. La rangée du bas s'imbrique parfaitement entre les deux rangées du haut, ce qui crée un mouvement de cisaillement idéal pour déchiqueter les proies. Son ancêtre a vécu et est mort ici, il y a environ 18 millions d'années. Le fragment de mâchoire retrouvée semble donc prouver qu'au moins une partie de la Zelandia est resté émergée. "Il ne fait aucun doute que presque tout le continent était sous l'eau, car on trouve du calcaire marin dans la majorité du pays. Mais, la structure biologie des fossiles laisse penser qu'il n'était pas entièrement submergé". Des animaux auraient donc continué à vivre sur des petites zones de terres émergées quand le reste de la Zelandia se trouver sous le niveau de la mer. "Il est impossible que tous ces animaux soient arrivés par la mer en si peu de temps. Comment auraient-ils fait ? Et d'où seraient-ils venus ? Leur origine n'est pas claire". Si le sphénodon est venu d'Australie sur un débris flottant, on devrait trouver trace de sa présence dans les archives fossiles de ce pays. Or, il n'en est rien ! Pour prouver qu'une portion des terres est bien restée émergée, il faudrait découvrir un fossile datant de la période où la Zelandia était sous les eaux.
L'un de ces débris et un fragment de la mâchoire d'un ancêtre du Sphénodon. Le sphénodon est un prédateur patient, il guette dans l'immobilité la plus totale jusqu'au dernier moment. Ses dents sont en fait les bords pointus de ses mâchoires. La rangée du bas s'imbrique parfaitement entre les deux rangées du haut, ce qui crée un mouvement de cisaillement idéal pour déchiqueter les proies. Son ancêtre a vécu et est mort ici, il y a environ 18 millions d'années. Le fragment de mâchoire retrouvée semble donc prouver qu'au moins une partie de la Zelandia est resté émergée. "Il ne fait aucun doute que presque tout le continent était sous l'eau, car on trouve du calcaire marin dans la majorité du pays. Mais, la structure biologie des fossiles laisse penser qu'il n'était pas entièrement submergé". Des animaux auraient donc continué à vivre sur des petites zones de terres émergées quand le reste de la Zelandia se trouver sous le niveau de la mer. "Il est impossible que tous ces animaux soient arrivés par la mer en si peu de temps. Comment auraient-ils fait ? Et d'où seraient-ils venus ? Leur origine n'est pas claire". Si le sphénodon est venu d'Australie sur un débris flottant, on devrait trouver trace de sa présence dans les archives fossiles de ce pays. Or, il n'en est rien ! Pour prouver qu'une portion des terres est bien restée émergée, il faudrait découvrir un fossile datant de la période où la Zelandia était sous les eaux.

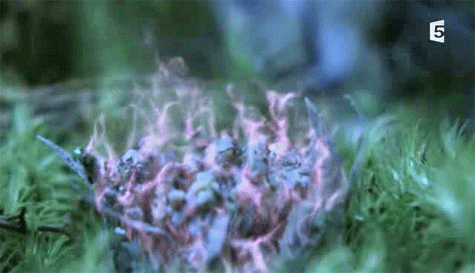
 Le site de fouilles à livrer d'autres éléments intéressants : des ossements de mammifères. Le Dactylantus, surnommé fleur d'Adès, apparaît une fois par an dans les forêts. Pour favoriser la pollinisation, cette étrange racine parasite sait créér une phéromone qui évoque la sueur de mammifères. Mais pourquoi une plante tenterait-elle d'attirer des mammifères dans un pays uniquement peuplé d'insectes et d'oiseaux ? En fait, il existe bel et bien un mammifère qui est parvenu jusqu'en Nouvelle-Zélande. Cet animal étrange boit le nectar de la fleur d'Adès et participe à sa pollinisation. Sur cette île remplit d'oiseau aux ailes inutiles, un mammifère peut voler... La chauve-souris à queue courte est une curiosité de la nature. Sa façon de fourrager est unique : elle replie ses ailes et les transforme en sorte de
Le site de fouilles à livrer d'autres éléments intéressants : des ossements de mammifères. Le Dactylantus, surnommé fleur d'Adès, apparaît une fois par an dans les forêts. Pour favoriser la pollinisation, cette étrange racine parasite sait créér une phéromone qui évoque la sueur de mammifères. Mais pourquoi une plante tenterait-elle d'attirer des mammifères dans un pays uniquement peuplé d'insectes et d'oiseaux ? En fait, il existe bel et bien un mammifère qui est parvenu jusqu'en Nouvelle-Zélande. Cet animal étrange boit le nectar de la fleur d'Adès et participe à sa pollinisation. Sur cette île remplit d'oiseau aux ailes inutiles, un mammifère peut voler... La chauve-souris à queue courte est une curiosité de la nature. Sa façon de fourrager est unique : elle replie ses ailes et les transforme en sorte de 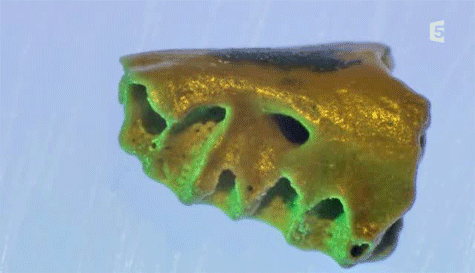 bras. Soutenu par ses pattes arrière adaptées à la marche, elle fouille le sol de la forêt. Les os fossilisés trouvés dans l'ancien lac prouvent qu'un de ses ancêtres vivait ici, il y a 18 millions d'années. Et puisque des fossiles de la même espèce ont été retrouvés en Australie, c'est probablement de là qu'il est venu : par la voie des airs.
bras. Soutenu par ses pattes arrière adaptées à la marche, elle fouille le sol de la forêt. Les os fossilisés trouvés dans l'ancien lac prouvent qu'un de ses ancêtres vivait ici, il y a 18 millions d'années. Et puisque des fossiles de la même espèce ont été retrouvés en Australie, c'est probablement de là qu'il est venu : par la voie des airs.
Mais ce n'est pas tout, on a également découvert les restes d'un autre mammifère. "On ignore à quelle espèce il est apparenté, mais c'est une forme de mammifères très archaïque". L'animal en question devait ressembler à un rongeur primitif. D'après les articulations de ses hanches, il se déplaçait en dandinant. Mais les os retrouvés ne sont pas assez nombreux pour compléter son portrait, pour expliquer comment il est arrivé là. Il a fini par disparaître sans doute à cause de bouleversements géologiques.
 La Nouvelle-Zélande est caractérisée par une activité volcanique intense, qui a différentes époques, à ébranler jusqu'à ses fondations. La faune qui s'y trouvait a donc dû évoluer à un rythme sans précédent. Certains animaux ont disparu, d'autres se sont adaptés. L'un de ceux-ci a connu une évolution extrême...
La Nouvelle-Zélande est caractérisée par une activité volcanique intense, qui a différentes époques, à ébranler jusqu'à ses fondations. La faune qui s'y trouvait a donc dû évoluer à un rythme sans précédent. Certains animaux ont disparu, d'autres se sont adaptés. L'un de ceux-ci a connu une évolution extrême...
Avec ses 4 kg, le Cacapo est le perroquet le plus lourd du monde. Avant de se percher, il doit soigneusement choisir sa branche. Cet oiseau n'est pas obèse, il est en parfaite condition physique. Mais ces ailes ne sont pas assez fortes pour le soulever, il ne peut donc pas voler... Comme bien d'autres oiseaux de ce pays, le cacapo se déplace en marchant au sol. Pourtant, sa nourriture préférée se trouve sur les arbres... Un gros perroquet, incapable de voler et qui grimpe aux arbres : c'est un cas de mutation réussie. Développer les muscles des ailes et voler demande beaucoup d'énergie. Dans un pays où les conditions de vie au sol sont parfaites, le cacapo a privilégié un corps capable de stocker des réserves de graisse. Cela lui permet de subsister que la nourriture se fait rare et d'avoir bien chaud quand il fait froid : deux avantages qui l'emportent sur l'attitude voler.

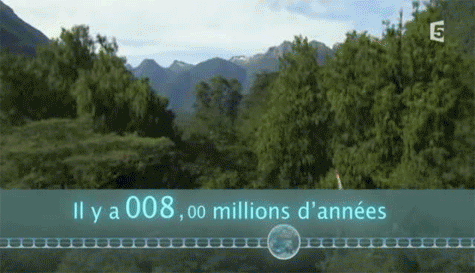
 Son proche cousin le Kéa (Nestor notabilis), sait en revanche se servir de ces ailes. Il est probable que l'ancêtre commun de ces deux perroquets volait. Mais l'évolution leur a fait prendre des chemins totalement différents.
Son proche cousin le Kéa (Nestor notabilis), sait en revanche se servir de ces ailes. Il est probable que l'ancêtre commun de ces deux perroquets volait. Mais l'évolution leur a fait prendre des chemins totalement différents.
Il y a environ 8 millions d'années, la Nouvelle-Zélande a connu un bouleversement géologique majeur. Les collisions entre les plaques tectoniques ont soulevé à 3500 m d'altitude l'épine dorsale du pays. Et dans l'île du Sud, la chaîne alpine continue à s'élever aujourd'hui de 3 cm par an. L'ancêtre du Kéa a évolué de manière à coloniser ces nouvelles montagnes : c'est le seul perroquet alpin au monde. Son épais plumage le protège du froid et son bec recourbé, à muter en un outil tranchant très utile pour arracher la végétation. Et pour dépasser les charognes...

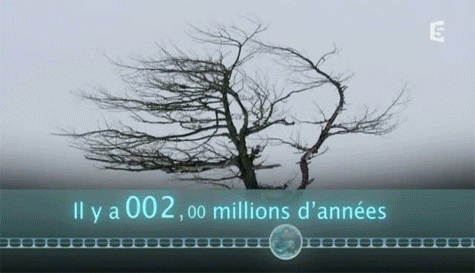 Il y a 2 millions d'années, la planète est entrée dans une période de glaciation. Toute la faune de la Nouvelle-Zélande a une nouvelle fois été poussée à des adaptations extrêmes. C'est probablement l'ère glaciaire qui a conduit le Cacapo a accumuler de la graisse pour se réchauffer. Le Kéa, lui, avait déjà son chaud plumage.
Il y a 2 millions d'années, la planète est entrée dans une période de glaciation. Toute la faune de la Nouvelle-Zélande a une nouvelle fois été poussée à des adaptations extrêmes. C'est probablement l'ère glaciaire qui a conduit le Cacapo a accumuler de la graisse pour se réchauffer. Le Kéa, lui, avait déjà son chaud plumage.
Le kiwi, lui aussi a dû s'adapter pour survivre au froid. Sa température est inférieure de 2°C à celle des autres oiseaux, ce qui lui permet d'économiser de l'énergie. Ce jeune mâle sent qu'une femelle approche... Elle est à la recherche d'un partenaire, ce qu'elle lui fait savoir par ses grognements. Le mâle ne se fait pas prier, ils resteront en couple toute leur vie. Celle-ci peut durer une trentaine d'années au cours desquelles ils auront un petits par an.
 Un curieux phénomène apparaît chez les oiseaux de Nouvelle-Zélande. Dans cet environnement protégé, beaucoup ont non seulement renoncé à voler, mais sont en outre, devenus nocturnes. En général, une telle adaptation est liée à la peur d'un prédateur. De quoi se cacher leurs ancêtres ?
Un curieux phénomène apparaît chez les oiseaux de Nouvelle-Zélande. Dans cet environnement protégé, beaucoup ont non seulement renoncé à voler, mais sont en outre, devenus nocturnes. En général, une telle adaptation est liée à la peur d'un prédateur. De quoi se cacher leurs ancêtres ?
Le gros cacapo entame un étrange rituel. Il est minuit et ce jeune adulte grimpe au sommet d'une colline. Il dégage un chemin jusqu'à une cuvette où il s'installe confortablement. À cinq ans, c'est sa première parade nuptiale. Toute la nuit, il va rivaliser avec les autres mâles pour attirer une femelle. Tout d'abord, il inspire profondément et se gonfle comme un ballon. Puis, il entame sa sérénade... L'air expulsé produit un mugissement à basse fréquence audible à des kilomètres à la ronde. Et pour mettre tous les atouts de son côté, il émet également une fragrance attirante (odeur). Cette agitation devrait alerter les prédateurs. Pourtant, le cacapo ne montre aucun signe de peur. Dès que des femelles approchent, il émet des petits cris aigus pour les guider vers lui. Le jeune cacapo manque d'expérience dans cette compétition où les mâles exhibent leurs talents et les femelles choisissent. Personne ne répond à son appel... Aux premières lueurs de l'aube, il se fond dans le paysage. Ces plumes marbrées de vert le rendent presque invisible.
Le Kéa cache également ses couleurs vives sous ses ailes, ce qui signifie qu'il doit se camoufler pour se protéger des rapaces. Le camouflage et le comportement nocturne sont les réponses de l'évolution à un prédateur qui chasse de jour et possède une vue perçante. Il y a 1 million d'années, cet animal a réussi à pénétrer dans le sanctuaire des oiseaux, et la vie en Nouvelle-Zélande en a été changé à jamais.

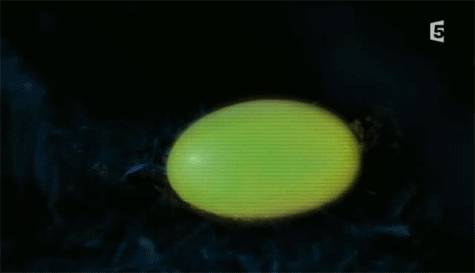
 Le kiwi femelle porte son ouf depuis 10 jours. Elle souffre beaucoup et trempe son ventre distendu dans une flaque d'eau fraîche pour se soulager. Elle va bientôt prendre le plus gros ouf du monde comparé à sa taille. Il est si gros qu'il occupe tout l'espace disponible dans le corps du kiwi. Il comprime ses organes, gêne sa respiration et ne laisse que peu de place pour la nourriture. Pourquoi les kiwis sont-ils soumis à une telle torture ? Une semaine plus tard, la femelle a pondu. Mais on ne la voit nulle part...
Le kiwi femelle porte son ouf depuis 10 jours. Elle souffre beaucoup et trempe son ventre distendu dans une flaque d'eau fraîche pour se soulager. Elle va bientôt prendre le plus gros ouf du monde comparé à sa taille. Il est si gros qu'il occupe tout l'espace disponible dans le corps du kiwi. Il comprime ses organes, gêne sa respiration et ne laisse que peu de place pour la nourriture. Pourquoi les kiwis sont-ils soumis à une telle torture ? Une semaine plus tard, la femelle a pondu. Mais on ne la voit nulle part...
Chez les Kiwis de Mantel, les rôles sont inversés. Le mâle couve seul pendant presque 80 jours : c'est la plus longue période d'incubation chez les oiseaux. Sa chaleur stimule le développement de l'embryon, mais il doit s'éloigner au moins une fois par jour pour se nourrir. Et durant son absence, l'ouf se refroidit dangereusement. Mais le kiwi à une stratégie pour supporter le froid : l'embryon suspend son développement pendant plus d'une heure, le temps que le mâle s'alimente. Sans surveillance, l'ouf de près de 500 g est vulnérable. Il pourrait constituer une prise de choix pour le mystérieux prédateur. Les animaux des îles présentent parfois une étrange particularité : le gigantisme. Le Moa était sans doute le plus grand oiseau de tous les temps. Il pesait 200 kg et mesurait 3 m de haut. était-ce lui, le fameux monstre que tous les animaux nocturnes cherchaient à éviter ? Heureusement pour le kiwi, il était herbivore et ne s'intéressait pas aux oufs.

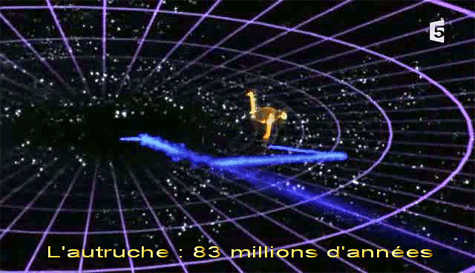 Et pourtant il existe bien un lien entre l'ouf du kiwi et le Moa disparu. Selon les tests ADN, les kiwis appartiennent au même groupe d'oiseaux coureurs issus du Gondwana : les ratites. L'autruche, est apparu en Afrique il y a 83 millions d'années. Et il y a 60 millions d'années, c'était le tour du Moa, de l'Emeu australien, du Casoar et du Kiwi. On a longtemps pensé que le Moa et le Kiwi arpentaient l'ancienne Zelandia et qu'ils avaient survécu à la montée des eaux en se réfugiant sur les terres émergées. Or, de récentes recherches génétiques prouvent qu'ils ont vécu en Australie avec leurs cousins pendant plusieurs millions d'années. Ce qui suggère que les Kiwis ont peut-être atteint la Nouvelle-Zélande avec leur petit bout d'ailes, comme les ancêtres du Moa. Ces derniers avaient besoin de gros intestin pour digérer la végétation dont il se nourrissait. En l'absence de prédateur, certains ont atteint une taille démesurée. Le kiwi a peut-être rapetissé, mais il a conservé l'énorme ouf de ses ancêtres géants. Si le Moa n'est plus suspect, qui était donc le prédateur tant redouté ?
Et pourtant il existe bien un lien entre l'ouf du kiwi et le Moa disparu. Selon les tests ADN, les kiwis appartiennent au même groupe d'oiseaux coureurs issus du Gondwana : les ratites. L'autruche, est apparu en Afrique il y a 83 millions d'années. Et il y a 60 millions d'années, c'était le tour du Moa, de l'Emeu australien, du Casoar et du Kiwi. On a longtemps pensé que le Moa et le Kiwi arpentaient l'ancienne Zelandia et qu'ils avaient survécu à la montée des eaux en se réfugiant sur les terres émergées. Or, de récentes recherches génétiques prouvent qu'ils ont vécu en Australie avec leurs cousins pendant plusieurs millions d'années. Ce qui suggère que les Kiwis ont peut-être atteint la Nouvelle-Zélande avec leur petit bout d'ailes, comme les ancêtres du Moa. Ces derniers avaient besoin de gros intestin pour digérer la végétation dont il se nourrissait. En l'absence de prédateur, certains ont atteint une taille démesurée. Le kiwi a peut-être rapetissé, mais il a conservé l'énorme ouf de ses ancêtres géants. Si le Moa n'est plus suspect, qui était donc le prédateur tant redouté ?

 L'Aigle géant de Haast (Harpagornis moorei), d'une envergure de 3 m, il était armé de serre semblable à des griffes de tigre. Il semait la terreur était assez puissant pour s'attaquer au Moa. Ces grottes calcaires abritent les restes de la plus extraordinaire dynastie d'oiseaux de Nouvelle-Zélande. Sur ce bassin de Moa qui date d'environ 1000 ans, on peut voir de profondes entailles faites par les serres d'un de ses aigles. Selon les tests ADN, l'ancêtre de l'aigle géant est venu d'Australie il y a 1 million d'années. En Nouvelle-Zélande, l'abondance de proies l'a rapidement fait évoluer jusqu'à une taille gigantesque. Puis, il y a 700 environ, un prédateur mammifère à débarquer en Nouvelle-Zélande : l'homme. Il a chassé le Moa, et l'espèce s'est éteinte en à peine 100 ans. Privé de sa principale proie, l'Aigle de Haast a subi le même sort. Aujourd'hui, la plupart des animaux sont toujours nocturnes. Le souvenir de l'aigle est encore frais dans leur mémoire génétique.
L'Aigle géant de Haast (Harpagornis moorei), d'une envergure de 3 m, il était armé de serre semblable à des griffes de tigre. Il semait la terreur était assez puissant pour s'attaquer au Moa. Ces grottes calcaires abritent les restes de la plus extraordinaire dynastie d'oiseaux de Nouvelle-Zélande. Sur ce bassin de Moa qui date d'environ 1000 ans, on peut voir de profondes entailles faites par les serres d'un de ses aigles. Selon les tests ADN, l'ancêtre de l'aigle géant est venu d'Australie il y a 1 million d'années. En Nouvelle-Zélande, l'abondance de proies l'a rapidement fait évoluer jusqu'à une taille gigantesque. Puis, il y a 700 environ, un prédateur mammifère à débarquer en Nouvelle-Zélande : l'homme. Il a chassé le Moa, et l'espèce s'est éteinte en à peine 100 ans. Privé de sa principale proie, l'Aigle de Haast a subi le même sort. Aujourd'hui, la plupart des animaux sont toujours nocturnes. Le souvenir de l'aigle est encore frais dans leur mémoire génétique.
 Le kiwi mâle couve son ouf depuis trois mois. C'est à peu près le temps de gestation qui correspond à un mammifère de la même taille. Les avantages de cet ouf géant deviennent évidents lorsque le poussin apparaît. Contrairement à la plupart des oiseaux, dès l'éclosion le kiwi est complètement formé et couvert de plumes.
Le kiwi mâle couve son ouf depuis trois mois. C'est à peu près le temps de gestation qui correspond à un mammifère de la même taille. Les avantages de cet ouf géant deviennent évidents lorsque le poussin apparaît. Contrairement à la plupart des oiseaux, dès l'éclosion le kiwi est complètement formé et couvert de plumes.
L'ouf lui fournit également son premier repas, la membrane vitaline qui gonfle le ventre de l'oisillon, le nourrit durant ses premières heures. Le poussin est quasiment autonome dès sa naissance. Cette stratégie était autrefois très efficace, mais de nos jours, un grave danger menace l'existence des jeunes kiwis.
L'hermine a fait parti des mammifères introduits par l'homme en Nouvelle-Zélande.  Elle est devenue endémique dans les forêts du pays et fait des ravages parmi les jeunes kiwis. Le poussin se cache dans son trou mais l'hermine l'a repéré grâce son odorat. Pour cette fois, le kiwi est sauf...
Elle est devenue endémique dans les forêts du pays et fait des ravages parmi les jeunes kiwis. Le poussin se cache dans son trou mais l'hermine l'a repéré grâce son odorat. Pour cette fois, le kiwi est sauf...
Les étranges animaux de Nouvelle-Zélande ont échappé à de nombreux dangers au cours de leur passé agité. Et l'histoire de ce pays est encore parmi bien des aspects une énigme...
La terre et l'océan ont englouti de nombreux indices. Mais de temps à autre, une pièce du puzzle refait surface, et le tableau de ce lieu unique s'enrichit sur une planète en constante mutation.
FRANCE 5 - Planète Mutante - Natural History New Zealand > 2010 |
|